« Je préfère l’espérance »
PARIS - Le silence dans la pièce est feutré. Deux agents de sécurité armés me prient sèchement de m’asseoir. Ils me montrent du doigt un fauteuil art déco qui fait face à un grand bureau posé sur un tapis persan. Il y a quelques bibelots, des statuettes de David Ben Gourion. Mais c'est par la vingtaine de volumes d’une édition ancienne de la Recherche du Temps Perdu que je suis frappé. Shimon Peres, le maître du lieu, a une réputation de grand lecteur. Il est aussi capable d’écrire un poème entre deux réunions. C’est aussi un champion de la communication. Proust, bien en évidence, sous le nez d’un journaliste français venu l’interviewer, ce n’est pas le fait du hasard. Il me le confirme dès son arrivée en me serrant la main avec fermeté.
« Marcel Proust, c’est la France », me dit celui qui est alors Premier ministre par intérim – nous sommes en novembre 1995.
 Shimon Peres dans son bureau de président d'Israël, en avril 2010 (AFP / Menahem Kahana)
Shimon Peres dans son bureau de président d'Israël, en avril 2010 (AFP / Menahem Kahana)L'accent est lourd, mélange de polonais, sa langue maternelle, et d’hébreu. En français, le cocktail est rocailleux et le choix des mots parfois approximatif. Avant de me demander de passer à l’anglais «plus confortable pour moi » (sic), il me gratifie d’un ultime « la France, c’est un peu comme une femme qu’on ne peut cesser d’aimer même si elle est volage ». La paire d'yeux bleus se plisse avec malice.
Les relations avec la France, plutôt fraiches à cette époque, c’est une partie essentielle de sa vie. Les femmes aussi, très sensibles au charme de sa voix grave. Il s'en est souvent entouré. Même si la seule qui a vraiment compté est sa femme, Sonia, rencontrée à l’époque où il gardait des moutons dans les collines arides de Ben Shemen, entre Tel Aviv et Jérusalem.
 Lauren Bacall et Humphrey Bogart, en 1951 à Paris (AFP / STF)
Lauren Bacall et Humphrey Bogart, en 1951 à Paris (AFP / STF)C’est le portrait d’une autre qui est posé sur son bureau. Il perçoit mon regard étonné et son sourire s’élargit franchement. J’ai en effet reconnu Lauren Bacall. Shimon Peres et Humphrey Bogart. Tous deux auraient donc aimé la même femme ? Je tiens un scoop.
« C’est ma cousine germaine », me rassure-t-il. J'ai l'impression qu'il se moque de moi mais il est très sérieux. Il me dit alors : « Nous portons le même nom, Perski ». La cousine de Szimon s'appelait Betty. Envolé, le scoop.
L’entretien commence, étrangement détendu. Etrangement, car trois semaines plus tôt, un funeste 4 novembre, son destin a basculé. Yitzhak Rabin a été assassiné. Shimon Peres était à ses côtés. Quelques minutes avant le drame, sur un podium, devant une foule compacte d’Israéliens en liesse, les deux hommes ont entonné un hymne à la paix.
Ennemis politiques jurés puis partenaires voire complices, ils ont peu de points communs. Outre leur conversion récente au pacifisme et le rapprochement inattendu avec leur nouvel ami, Yasser Arafat, les deux hommes partagent cependant un même défaut : ils chantent horriblement faux. Ce n’est pas ce que l’Histoire retiendra mais mes oreilles s’en souviennent jusqu'à aujourd'hui.
 Yitzhak Rabin (à droite) et Shimon Peres saluent la foule lors d'un rassemblement pour la paix à Tel Aviv le 4 novembre 1995, quelques instants avant l'assassinat du Premier ministre (AFP / Sven Nackstrand)
Yitzhak Rabin (à droite) et Shimon Peres saluent la foule lors d'un rassemblement pour la paix à Tel Aviv le 4 novembre 1995, quelques instants avant l'assassinat du Premier ministre (AFP / Sven Nackstrand)Pour le reste, ils appartiennent à deux mondes très différents. Rabin est un soldat, un « sabra » qui a gravi les échelons de la hiérarchie militaire puis politique à la force du poignet. Peres a pour sa part un itinéraire qui commence comme celui d'un enfant gâté. Il lui a suffi de faire du stop sur une route désertique dans le Néguev pour lancer sa carrière. Assis à l'arrière de la voiture qui vient de s'arrêter, un petit homme aux cheveux blancs ébouriffés et aux yeux perçants le prend immédiatement en affection et sous son aile. C'est David Ben Gourion, surnommé « le Vieux », le père fondateur du pays et son premier chef du gouvernement qui va immédiatement en faire son assistant personnel.
Au même moment, Rabin, arme au poing, se bat contre les Anglais qui occupent la Palestine. Au sein du Parti travailliste que dirige Ben Gourion, on se méfie donc de Peres, des missions secrètes que lui sont confiées, de son ascension météorique pour quelqu'un qui n'a jamais porté une arme. On le surnomme alors « le costard bleu » à une époque où les ministres marchent en sandales, le col de chemise grand ouvert.
 Shimon Peres à bord d'un hélicoptère en route pour le Liban, en novembre 1984 (AFP)
Shimon Peres à bord d'un hélicoptère en route pour le Liban, en novembre 1984 (AFP)Dans son bureau, j’évoque avec lui les heures sombres qui suivent la mort du Premier ministre. Je lui dis que je me trouvais à ce moment avec un petit groupe de journalistes dans les sous-sols du ministère de la Défense à Tel Aviv, que nous avions précipitamment quitté l’hôpital Ichilov où le porte-parole de Rabin, Eytan Haber, avait annoncé d'une voix tremblante la nouvelle, que nous l’attendions. Une attente pesante, sous un néon diffusant une lumière blafarde, autour d'une longue table qui coupe en deux la pièce sans fenêtre, totalement insonorisée. C’est là, à l’abri de toute écoute, que se tiennent les réunions sécuritaires les plus secrètes, que des opérations militaires sont lancées et supervisées. Les chaises disposées autour sont vides. Posée sur l’une d’elle, il y a une grande photo de Rabin, un coin barré d’un bandeau noir.
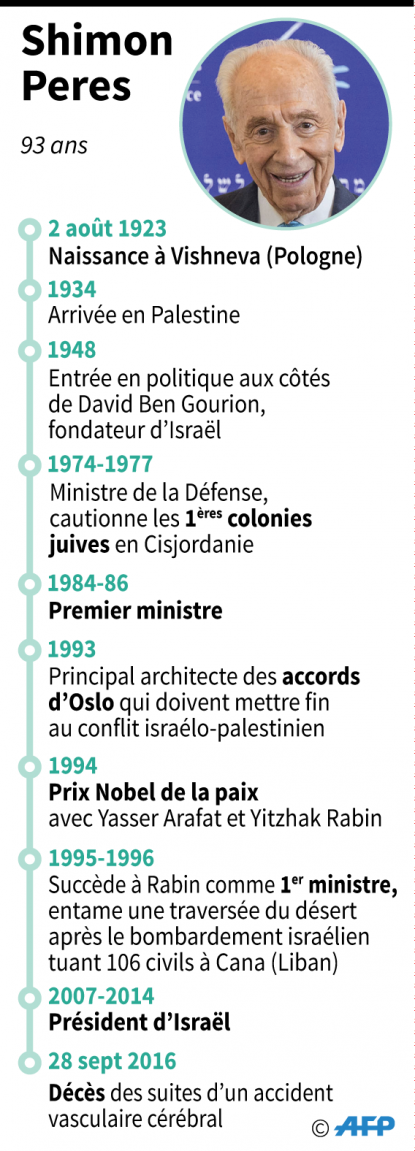
Je l'ai déjà approché à plusieurs reprises avant cet épisode, mais jamais il ne m'est apparu aussi blême. Il pénètre d'un pas vif, encadré de ses gardes du corps visiblement très tendus et abattus par ce qui vient de se produire. Ce sont leurs camarades qui n'ont pas pu empêcher l'assaillant d'ouvrir le feu à bout portant contre Rabin. Ils auraient pu être à leur place.
Peres leur parle à l'oreille, comme un père qui rassure ses enfants. Je comprends alors qu'il a pris un sérieux coup. Il semble plus sage. Fini le Peres politicard, l'homme des coups tordus et autres manœuvres politiciennes. L'Histoire vient de lui donner une opportunité qu'aucune élection n'a jamais pu lui offrir. Dans un geste presque napoléonien, il tapote l'épaule basse d'un des agents qui lui renvoie un sourire triste, puis s'assoit. Il nous regarde tous l'un après l'autre, nous reconnait, nous salue d'un léger signe de tête. Il sait que nous sommes nous aussi sous le choc de ce qui vient de se passer. Je me prends à croire qu'il va nous rassurer nous aussi, sans trop savoir pourquoi.
Après une longue inspiration, il prend la parole. Le ton est grave, empreint d’émotion mais déterminé. Il a les mains serrées sur la table, comme pour les empêcher de trembler. Il dit qu'il va assurer la fonction de Premier ministre par intérim, poursuivre ce que l’on appelle encore « le processus d’Oslo » et avancer de six mois la date des élections législatives prévue pour l’année suivante.
Dans son bureau, je lui demande ce qui lui passe par la tête à ce moment précis de sa vie et de sa carrière.
«Garantir la stabilité. Ne pas risquer le chaos. Rassurer autant que possible. Mais J’étais sous le choc. Je le suis toujours. Comme le reste du pays. C’est la première fois qu’on assassine un dirigeant en Israël. Nous avons notre Kennedy maintenant. Et je n’en suis pas fier ».
Pas fier, mais il endosse son nouveau costume avec brio. Il a déjà occupé le même fauteuil en 1976 en remplaçant Rabin déjà d'avril à juin 1977 lorsque celui-ci est contraint de démissionner pour avoir entretenu un compte en banque à l'étranger au nom de Léa, sa femme. Il revient aux commandes en 1984 pour deux ans. Il a dû pour cela, comme il le dit lui-même « avaler une grosse couleuvre » en l'occurrence Yitzhak Shamir, le chef de la droite qui va le remplacer de 1986 à 1988 à la tête de ce gouvernement bicéphale.
J'hésite, mais je lui demande tout de même comment il a vécu ses longues années d'impopularité, la réputation d'un animal politique retors que lui a collé Rabin, le fait qu'il n'a jamais remporté une élection et qu'il se retrouve à nouveau à succéder à un homme considéré comme l'un des héros militaires de son pays, tombé au champ d'honneur pour avoir serré la main d'Arafat. Le visage se ferme imperceptiblement. Je me dis que l'interview va tourner court mais il prend une profonde inspiration.
 Un parlementaire se recueille devant la dépouille de Shimon Peres à la Knesset, le 29 septembre 2016 (AFP / Gali Tibbon)
Un parlementaire se recueille devant la dépouille de Shimon Peres à la Knesset, le 29 septembre 2016 (AFP / Gali Tibbon)« Je n'ai jamais été soldat, c'est vrai, mais il y a d'autres moyens de se battre pour son pays et ils sont tout autant légitimes ».
Il me rappelle qu'à 29 ans il a été le plus jeune directeur général du ministère israélien de la Défense ; qu'à cette époque, il dispose aussi de son bureau au ministère français de la Défense à Paris. Il y négocie des achats d'armes en tous genres : des chars, des tanks, des fusils. Il est si proche de Guy Mollet et de Maurice Bourgès-Maunoury que certains fonctionnaires parisiens le prennent souvent pour l'un des leurs.
 Shimon Peres à Paris, en janvier 1981 (AFP / Georges Gobet)
Shimon Peres à Paris, en janvier 1981 (AFP / Georges Gobet)C'est l'époque de l'âge d'or des relations franco-israéliennes, celle où Georges Brassens est traduit et chanté en hébreu et où les questions de sécurité du jeune Etat sont discutées en priorité à Paris. C'est aussi dans ces sphères de la IVème République que les dirigeants français décident d'aider les Israéliens à se doter d'un réacteur nucléaire. Peres insiste sur le mot « réacteur » et évite soigneusement celui de « bombe ». Le sourire à nouveau, un brin ironique.
Il semble avoir oublié que je l'ai irrité une minute plus tôt en lui rappelant qu'il était plus à l'aise en costume foncé, le cou enserré dans une cravate qu'en « battle-dress ». Il en faut plus pour le déstabiliser. Même ceux qui lui lançaient des tomates alors qu'il venait serrer des mains dans les allées du marché de Makhané Yéhouda à Jérusalem, en pleine campagne électorale, n'ont pas réussi à lui faire mettre un genou à terre.
 Une sympathisante du Parti travailliste israélien et un portrait du défunt Premier ministre Yitzakh Rabin, quelques instants après l'annonce de la défaite de justesse de Shimon Peres face au candidat du Likoud Benjamin Netanyahu aux élections de mai 1996 (AFP / Sven Nackstrand)
Une sympathisante du Parti travailliste israélien et un portrait du défunt Premier ministre Yitzakh Rabin, quelques instants après l'annonce de la défaite de justesse de Shimon Peres face au candidat du Likoud Benjamin Netanyahu aux élections de mai 1996 (AFP / Sven Nackstrand)« J'ai toujours su rebondir et retomber sur mes deux pieds », lâche-t-il.
Même lorsqu'il était au plus bas. C'est à ce moment que je le rencontre à nouveau. Nous sommes au lendemain de la nuit mémorable du 30 mai 1996. Il vient de perdre d'un cheveu le scrutin qui l'oppose au chef de la droite, un animal politique d'un autre type, Benjamin Netanyahu, que personne n'a vu venir et ne donnait gagnant, surtout après l'assassinat de Rabin par un extrémiste de droite. La défaite est d'autant plus cuisante que c'est la première élection directe d'un Premier ministre en Israël. Et elle est d'autant plus douloureuse que Peres a déjà sablé le champagne de la victoire dans son appartement de Ramat Aviv puisque les résultats le donnaient vainqueur durant la plus grande partie de la nuit. Au lever du jour, une longue traversée du désert commence. Il s'en relèvera encore et finira par accéder à la fonction honorifique de Président de l'Etat.
Plusieurs années après, en 2007, je le rencontre à nouveau. J'écris un livre sur la menace nucléaire iranienne. Il est l'un des artisans du programme nucléaire israélien et donc incontournable sur ce sujet. En me gratifiant du même sourire, il me dira, bien droit dans ses bottes et au mépris des règles de la censure militaire de l'époque : « Vous savez, Israël n’a pas l’arme atomique. Mais que personne ne prenne le risque de nous forcer à y recourir ».
De ces quelques rencontres souvent brèves à la sortie d'un conseil des ministres, parfois plus longues dans son bureau ou la dernière dans son Centre pour la Paix à Tel Aviv, je garde le souvenir d'un homme unique par sa ténacité, ses contradictions multiples, sa naïveté enfantine parfois, et son incorrigible optimisme. Un mot qu'il n'aimait pas particulièrement. « Je préfère espérance », disait-il.
Lorsque je lui ferai part de mon scepticisme après la parution de son livre au titre hautement prometteur Le Nouveau Moyen-Orient dans lequel il développera toute sa vision du rapprochement entre Israéliens et Arabes dans cette région, il me conseillera de le relire en « travaillant sur moi-même afin de rester jeune et optimiste ».
 Shimon Peres, alors ministre des Affaires étrangères, pendant un débat à la Knesset en septembre 1993 sur le projet d'accord de paix entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine (AFP / Yoav Lemmer)
Shimon Peres, alors ministre des Affaires étrangères, pendant un débat à la Knesset en septembre 1993 sur le projet d'accord de paix entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine (AFP / Yoav Lemmer)






