Retour vers la planète des cendres
Le travail a commencé autour d'un verre de Limoncello un midi de novembre ensoleillé. Nous étions dans un village israélien où, murmure-t-on entre les citronniers, a vécu le grand historien Yuval Noah Harari. Le rendez-vous n'avait pas été pris avec des proches de l'auteur du best-seller "Sapiens: une brève histoire de l'humanité", mais avec un survivant d'Auschwitz, qui a vécu dans sa chair une longue histoire d'inhumanité. Danny Chanoch, yeux pétillants et humour corrosif, a été en quelque sorte notre guide, le premier à se plier à l'exercice. Et nous l'en remercions encore.
 Le déporté Danny Chanoch, 87, pose avec une image prise après la guerre de son frère aîné Uri chez lui, à Karmei Yosef dans le centre d'Israël, le 10 décembre 2019. Né en Lituanie en 1933 il a retrouvé son frère en Italie et ils ont émigré ensemble en Palestine, alors sous mandat britannique, en 1946.
(AFP / Menahem Kahana)
Le déporté Danny Chanoch, 87, pose avec une image prise après la guerre de son frère aîné Uri chez lui, à Karmei Yosef dans le centre d'Israël, le 10 décembre 2019. Né en Lituanie en 1933 il a retrouvé son frère en Italie et ils ont émigré ensemble en Palestine, alors sous mandat britannique, en 1946.
(AFP / Menahem Kahana)En novembre, une équipe du bureau de l'AFP à Jérusalem a lancé le projet. Notre but était d'aller à la rencontre des derniers rescapés d'Auschwitz vivant en Israël et d'en faire un grand reportage pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi. Nous avons déployé un mini-studio mobile permettant d'avoir un fond commun, sobre, et des éclairages pour réaliser les portraits de ces témoins de l'enfer.
 (AFP / Menahem Kahana)
(AFP / Menahem Kahana)Avec sa bonhommie, ses blagues au vitriol, ses souvenirs accrochés sur ses murs et plantés dans son coeur, Danny Chanoch nous a permis d'amorcer notre plongée par une remarque inusitée: "Je ne sais pas comment j'aurais pu vivre sans Auschwitz". L'homme ne pleure pas la nuit, n'est pas foudroyé, terrassé par des flashbacks, mais a les camps de la mort chevillés à l'âme. Ils font partie de lui. De ce qu'il a été et de ce qu'il est devenu. Et ne peut imaginer sa vie autrement...
C'est un peu étrange de débarquer chez des gens, de monter un studio dans leur salon, pour leur demander de bien vouloir déballer leur vie, de leur demander de replonger en enfer pour répondre à nos questionnements de reporters. Mais il y avait chez eux une volonté de transmettre aux générations futures, pour qui le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie peut sembler vague, presque sans emprise sur leur présent. Mais il y a chez ces survivants l'idée d'un devoir. Des mémoires affectives, mais variables.
 Shmuel Blumenfeld, 94 ans, chez lui, à Bat Yam, au sud de Tel Aviv, le 28 novembre 2019. Il a prélevé un peu de terre de chaque lieu où ses proches ont été tués et l'a conservée dans de petits sacs jaunis qui devront être enterrés avec lui, quand il s'en ira. (AFP / Menahem Kahana)
Shmuel Blumenfeld, 94 ans, chez lui, à Bat Yam, au sud de Tel Aviv, le 28 novembre 2019. Il a prélevé un peu de terre de chaque lieu où ses proches ont été tués et l'a conservée dans de petits sacs jaunis qui devront être enterrés avec lui, quand il s'en ira. (AFP / Menahem Kahana)Certains survivants sont des encyclopédies vivantes de Shoah: vous leur posez une première question et la réponse s'étire sur 30 minutes. Mais peut-on interrompre un survivant d'Auschwitz? Et si oui, comment? Quelle dose de tact utiliser? Fait-on encore preuve de tact lorsqu'il faut hausser la voix car l'interviewé, à 90 ans passé, n'entend plus comme dans sa prime jeunesse.
C'est ce qui est arrivé chez Shmouel Blumenfeld, 94 ans. "Mais vous ne voulez pas savoir?", a rétorqué l'ancien gardien de prison israélien lorsque nous avons dû interrompre une de ses réponses. Schmouel faisait jour par jour la chronologie de la Shoah...
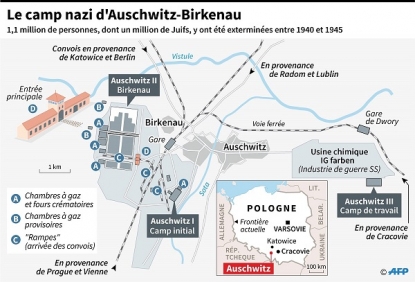
Cependant nous n'étions pas chez lui pour refaire l'histoire du génocide juif à l'heure près, mais bien pour savoir comment, lui, Schmouel, avait survécu. Comment, lui, avait vécu sa vie après la guerre; comment, lui, avait élevé ses enfants après Auschwitz; et qu'est-ce que lui, Schmouel, voulait transmettre aux générations futures? Il fallait donc jeter un peu de sable dans l'engrenage de sa mémoire, pour tenter d'accéder à l'homme dans sa chair. A ses sentiments, à ce qui est resté en lui de tout ça.
Je ne dis pas que nous y sommes parvenus, mais c'était le défi. Le but. A un moment, Shmouel Blumenfeld a revécu devant nous sa rencontre avec Adolf Eichmann, l'organisateur de la Solution finale.
 L'organisateur de la solution finale Adolf Eichmann lors de sa prestation de serment à l'ouverture de son procès le 5 mai 1961 à Jérusalem. Condamné à mort, il a été exécuté le 30 mai 1962.
L'organisateur de la solution finale Adolf Eichmann lors de sa prestation de serment à l'ouverture de son procès le 5 mai 1961 à Jérusalem. Condamné à mort, il a été exécuté le 30 mai 1962.
Ce nazi a été jugé 16 ans après la guerre à Jérusalem. Et Schmouel était l'un des gardiens de prison du dirigeant nazi. La scène de leur échange, rejouée par Shmouel en allemand, était franchement troublante, comme s'il la revivait, comme s'il extirpait de ses tréfonds un morceau caché du passé pour le ramener au présent.
Plusieurs rescapés étaient à la pointe des larmes, sans jamais franchir ce Rubicon. Il fallait montrer l'image de la force, de la victoire, d'un peuple presque téflon, qui avance dans l'histoire malgré l'adversité, qui jamais ne fléchit.
 De gauche à droite, les survivants d'Auschwitz Szmul Icek, Malka Zaken, Shmuel Blumenfeld, Saul Oren, Batcheva Dagan et Menahem Haberman. (AFP / Menahem Kahana)
De gauche à droite, les survivants d'Auschwitz Szmul Icek, Malka Zaken, Shmuel Blumenfeld, Saul Oren, Batcheva Dagan et Menahem Haberman. (AFP / Menahem Kahana)Et il y aussi ceux qui n'avaient de leur vie jamais cherché les caméras, et que les caméras aussi n'avaient peut-être jamais cherchés. Parmi eux, Szmul Icek.
Depuis un accident il y a de nombreuses années, l'homme ne peut plus parler. Ou peine, au mieux, à tousser quelques mots. Lorsque Szmul a réussi à pousser un "c'est pas possible" en enserrant son cou de ses mains pour mimer la mort autour de lui à Auschwitz, nos yeux se sont mouillés. A nous tous, Michaël, Ahikam, Menahem et moi.
Nous aurions voulu serrer Szmul dans nos bras. Nous sentions l'émotion d'un homme qui a vécu sa vie avec le souvenir de ses deux parents et ses deux soeurs tués par les nazis. Devant, ou avec Szmul, nous étions devenus la rivière dans laquelle nous étions allés pêcher. Nous avions, ne serait-ce qu'un instant, le sentiment de vivre sa peine avec lui.
 La rescapée d'Auschwitz Malka Zaken, 91 ans, avec ses poupées chez elle à Tel Aviv, le 16 décembre, 2019. Née en Grèce en 1928, elle avait 12 ans quand elle a été déportée vers le camp d'extermination où elle avait pour tâche de plier les vêtements des juifs tués dans la chambre à gaz. (AFP / Menahem Kahana)
La rescapée d'Auschwitz Malka Zaken, 91 ans, avec ses poupées chez elle à Tel Aviv, le 16 décembre, 2019. Née en Grèce en 1928, elle avait 12 ans quand elle a été déportée vers le camp d'extermination où elle avait pour tâche de plier les vêtements des juifs tués dans la chambre à gaz. (AFP / Menahem Kahana)Il y a aussi eu Malka Zaken qui nous a accueillis entourée de poupées en serrant l'une d'elle dans ses bras pour lui dire: "Ne t'en fais pas (...) ils ne sont pas Allemands", en nous regardant. Son trauma criait. Il était là, devant nous. Idem pour Helena Hirsch qui racontait comment, gamine, elle avait dû survivre, la peur au ventre, dans un camp de concentration; et comment elle avait réussi à se cacher pour éviter d'être gazée. C'est comme si l'enfant horrifiée de jadis ressurgissait du passé pour réapparaître devant nous.
Ces semaines de longs entretiens ont creusé en nous un étrange sillon d'anxiété. Que garder de tout ça? Chaque histoire, chaque récit, étant à ce point fort, déchirant, troublant, comment les réunir dans un seul texte sans trahir personne? Comment faire les ponts entre les histoires de chacun? Comment être à la hauteur?
 Batcheva Dagan, née en Pologne en 1925 a perdu toute sa famille pendant la guerre. Rescapée d'Auschwitz, elle a consacré toute sa vie à transmettre la mémoire de cet enfer, notamment aux enfants. (AFP / Menahem Kahana)
Batcheva Dagan, née en Pologne en 1925 a perdu toute sa famille pendant la guerre. Rescapée d'Auschwitz, elle a consacré toute sa vie à transmettre la mémoire de cet enfer, notamment aux enfants. (AFP / Menahem Kahana)En journalisme, le récit, me semble-t-il, doit être au diapason des gens. Il doit traduire le réel, le calquer, l'épouser. Je n'écris pas un article sur les survivants de la Shoah âgés de 90 ans comme un reportage coup de poing. Le moment fort n'est pas nécessairement au premier paragraphe. Il s'impose, dans le respect et la dignité des victimes. Ces survivants formaient un choeur, rappelant les horreurs de la Shoah, incarnant chacun des moments forts: la séparation des parents, la faim, la terreur, la marche de la mort, la quête de justice, le souci de transmettre, la suite du monde....
Les silences parlants, les larmes retenues et les pleurs vécus de ces survivants de la "planète de cendres", pour reprendre l'expression de l'écrivain israélien rescapé d'Auschwitz Yehiel Dinur, ont laissé leur trace en nous. Ahikam, Menahem et Michaël sont Israéliens. L'histoire de la Shoah a chez eux une résonance toute particulière. D'autant que certains membres de la famille de Menahem et Michaël ont été tués en Europe par les nazis.
 Dov Landau, 91, avec les portraits de ses parents, tués par les nazis lors d'une séance photo chez lui, à Tel Aviv, le 16 décembre 2019. Né en Hongrie en 1928 il est retourné à Auschwitz plus de 100 fois avec des groupes d'écoliers notamment. (AFP / Menahem Kahana)
Dov Landau, 91, avec les portraits de ses parents, tués par les nazis lors d'une séance photo chez lui, à Tel Aviv, le 16 décembre 2019. Né en Hongrie en 1928 il est retourné à Auschwitz plus de 100 fois avec des groupes d'écoliers notamment. (AFP / Menahem Kahana)Pour citer directement Michaël: "Je n'ai pas connu mon grand-père qui avait survécu à Auschwitz mais qui est mort avant ma naissance. Aller à la rencontre des derniers survivants du pire camp de la mort nazi, c'était aussi l'occasion pour moi d'entendre le quotidien de mon grand-père dont je porte le prénom, de la bouche de ceux qu'il avait peut-être côtoyés".
 Le survivant Saul Oren, matricule 125421 à Auschwitz lors d'une séance photo chez lui à Jérusalem le 2 décembre 2019. Né en Pologne en 1929, il notamment été le cobaye d'un médecin nazi. Après la guerre il a retrouvé son frère, également déporté à Auschwitz et a émigré en Israël. (AFP / Menahem Kahana)
Le survivant Saul Oren, matricule 125421 à Auschwitz lors d'une séance photo chez lui à Jérusalem le 2 décembre 2019. Né en Pologne en 1929, il notamment été le cobaye d'un médecin nazi. Après la guerre il a retrouvé son frère, également déporté à Auschwitz et a émigré en Israël. (AFP / Menahem Kahana)Cet écho de la mémoire nous l'avons ressenti lors des entretiens. Mais aussi après, en écrivant, en éditant, où le but visé était la sobriété. Mais une sobriété qui dérange, qui produit un effet au fil des témoignages de ces "vieillards", de ces derniers survivants, qui n'étaient que gamins, des enfants ou adolescents lorsqu'ils ont rencontré le mal absolu.
 (AFP / Guillaume Lavallée)
(AFP / Guillaume Lavallée)Aussi futile que cela puisse paraître, sur la "planète web" d'aujourd'hui, les dizaines de milliers de "partages" de notre reportage nous réjouissent. Et nous convainquent de la pertinence du long format, qu'il y a bien une quête des lecteurs pour dépasser l'instant, que la conscience de la Shoah persiste.
Voilà, il faudra bien un jour, avant novembre, aussi célébrer ça, en toute sobriété, en buvant un deuxième verre de Limoncello chez Danny Chanoch.
 Tatouage de matricule d'Avraham Gershon Binet, 81 ans, N° 14005, de Szmul Icek, N° 117568, de Menahem Haberman, 92 ans, N° A10011, et de Batcheva Dagan, N° 45554 (AFP / Menahem Kahana)
Tatouage de matricule d'Avraham Gershon Binet, 81 ans, N° 14005, de Szmul Icek, N° 117568, de Menahem Haberman, 92 ans, N° A10011, et de Batcheva Dagan, N° 45554 (AFP / Menahem Kahana)Récit écrit par Guillaume Lavallée, avec Michaël Blum, Ahikam Sei et Menahem Kahana à Jérusalem. Edition: Michaëla Cancela-Kieffer à Paris.


