A Cuba… enfin!
LA HAVANE, 26 novembre 2015 – J’ai réservé mes billets pour La Havane il y a 15 ans. C’est le temps qu’il m’a fallu pour y arriver.
A l’époque, j’étais un étudiant américain de 20 ans, et ma professeur d’espagnol du lycée, une charmante Argentine mariée à un diplomate des Nations Unies, m’avait invité à leur rendre visite à Cuba, où son mari venait d’être nommé.
Elle avait vécu aux quatre coins du monde avant d’arriver à Muncie, dans l’Indiana, la petite ville où j’avais été au lycée et où son mari enseignait à l'université pendant son temps libre.
Elle s’était donnée pour mission de faire découvrir le monde des arts, des idées et des voyages à nous autres, petits étudiants du Midwest. Très vite, elle était devenue mon enseignante préférée.
Nous étions restés en contact ensuite et, quand elle m’a invité à Cuba, je me suis dit : « c’est la chose la plus cool qui me soit jamais arrivée ».
J’étais fasciné par cette île si proche de la Floride mais si lointaine aussi, ses boulevards de bord de mer, ses vieilles berlines américaines, ses bâtiments coloniaux décrépis… Une île interdite, en raison de l’embargo américain.
 Le Malecon de La Havane, en septembre 2015 (AFP / Filippo Monteforte)
Le Malecon de La Havane, en septembre 2015 (AFP / Filippo Monteforte)Pour contourner cet obstacle, j’avais acheté un billet qui passait par Kingston, en Jamaïque. C’est là que ma professeure m’avait appelé pour me dire qu’elle devait annuler.
C’était alors l’été de l’affaire Elian Gonzalez, le petit garçon cubain de cinq ans retrouvé sur une embarcation de fortune après le naufrage du bateau qui le transportait, avec sa mère et douze autres réfugiés cubains partis chercher un meilleur avenir aux Etats-Unis. L’histoire avait vite pris des proportions monumentales entre les deux pays ennemis de la Guerre froide : sa famille à Miami voulait le garder. Son père à Cuba réclamait son retour.
Dégonflé
Ma professeure m’avait dit que son mari avait reçu des menaces de mort – venant sans doute d’un groupe d’exilés cubains, selon elle – après avoir appelé publiquement au retour d’Elian auprès de son père. Le couple avait donc décidé de quitter Cuba en attendant que les choses se calment.
 Une affiche devant le bureau des intérêts américains à La Havane réclame le retour du petit Elian Gonzalez, en décembre 1999 (AFP / Niurka Barroso)
Une affiche devant le bureau des intérêts américains à La Havane réclame le retour du petit Elian Gonzalez, en décembre 1999 (AFP / Niurka Barroso)J’aurais encore pu aller à La Havane tout seul, mais soudain j’avais pris peur. Je n’étais pas un voyageur expérimenté. Les tensions entre les deux pays ne cessaient de monter. Et je risquais gros en contournant l’interdiction faite aux touristes américains de se rendre à Cuba : jusqu’à dix ans de prison et 50.000 dollars d’amende, selon la loi.
Bref, je m’étais dégonflé.
Quinze ans plus tard, je travaille comme correspondant étranger pour l’AFP, au sein du siège de l’agence pour l’Amérique latine à Montevideo. J’ai déjà voyagé dans le monde entier pour mon travail… mais pas encore à Cuba.
Ma chance est venue avec l’annonce de la visite du pape François, qu’on me demande de couvrir.
 Une affiche souhaite la bienvenue au pape François dans une rue de La Havane, le 30 août 2015 (AFP / Yamil Lage)
Une affiche souhaite la bienvenue au pape François dans une rue de La Havane, le 30 août 2015 (AFP / Yamil Lage)C’est comme si j’avais 20 ans à nouveau. Et je dis : « C’est la mission la plus cool qui me soit jamais arrivée ».
Cette fois, je vais faire les choses dans les règles. Les journalistes sont une des douze catégories de voyageurs américains autorisés à se rendre à Cuba. Je suis tellement excité de réaliser enfin mon rêve que je décide d’embarquer avec moi ma femme et ma fille âgée de huit mois. La première est française et la seconde a l’embarras du choix entre un passeport français, un uruguayen et un troisième, américain. Elles n’ont donc pas à se soucier de l’embargo.
Logistique effrayante
Notre seul souci, finalement, est de penser aux affaires du bébé. Le directeur du bureau de l’AFP à La Havane, Alexandre Grosbois, et sa femme nous ont prévenus : il est presque impossible de trouver sur l’île des couches, des lingettes, des petits pots… Bref, tout ce qui a à voir de près ou de loin avec un bébé est quasi-introuvable à Cuba. Nous allons devoir tout emporter avec nous pour pouvoir tenir deux semaines. Une logistique effrayante.
 Une touriste à La Havane, en décembre 2014 (AFP / Adalberto Roque)
Une touriste à La Havane, en décembre 2014 (AFP / Adalberto Roque)Et ma femme va devoir s’occuper seule de notre fille pendant la première semaine, où je serai occupé à couvrir la visite du pape.
Mais elle dit oui à ce plan un peu fou. Je retombe immédiatement amoureux, bien sûr.
Nous prenons donc un guide de voyage, réservons une voiture de location et commençons à préparer l’itinéraire que nous suivrons une fois que le pape aura quitté l’île (Hum. Note pour le département du Trésor américain : c’est un voyage à des fins journalistiques, rien à voir avec des vacances. Ne me mettez pas en prison, ne m’infligez pas d’amende, s’il vous plaît).
 Une rue de La Havane, en décembre 2013 (AFP / Adalberto Roque)
Une rue de La Havane, en décembre 2013 (AFP / Adalberto Roque)Pour obtenir mon visa de journaliste, je dois me soumettre aux vérifications de l’ambassade cubaine : deux rendez-vous avec un responsable officiel qui a l’air frigorifié dans l’hiver uruguayen et dont la mission, j’imagine, serait de m’empêcher de partir s’il découvrait que je travaille pour la CIA. Visiblement, je n’ai pas trop l’air suspect car ses questions sont assez innocentes. Il passe la majorité de son temps à me donner des conseils touristiques.
En fait, tout le monde a l’ambassade se montre très enthousiaste, m’offre plein de conseils sur les endroits à voir à Cuba, les choses à faire et la meilleure façon de rafraîchir un bébé dans la chaleur tropicale.
A l’arrivée à Cuba, l’accueil est encore plus chaleureux : les chauffeurs de taxi, les serveurs, les vendeurs sur le marché et même de simples inconnus dans la rue sont ravis de rencontrer un Américain et de parler de la récente réconciliation entre les deux pays, aidée justement par le pape.
 Portrait de Fidel Castro à l'entrée d'un hôtel à La Havane, en janvier 2015 (AFP / Yamil Lage)
Portrait de Fidel Castro à l'entrée d'un hôtel à La Havane, en janvier 2015 (AFP / Yamil Lage)« Il n’y a jamais eu de problèmes entre le peuple cubain et le peuple américain. C’est un problème entre nos gouvernements », m’assure un matin un chauffeur de taxi qui me conduit au bureau dans une splendide Chevrolet Bel Air turquoise de 1957.
Un nombre incroyable de Cubains me font des confidences similaires. Mais si je suscite un certain intérêt auprès de la population locale, ce n’est rien à côté de la ferveur qui se déchaîne autour de ma fille !
Les Cubains sont littéralement fous des bébés, je n’avais jamais vu ça dans aucun autre pays. Et notre fille, jolie petite blondinette, est une superstar partout où elle va.
 Un restaurant privé à La Havane, en décembre 2014 (AFP / Yamil Lage)
Un restaurant privé à La Havane, en décembre 2014 (AFP / Yamil Lage)Cuba est la destination idéale pour les vacanciers ayant de jeunes enfants : dans les « casas particulares » où nous logeons – des maisons privées ouvertes depuis quelques années aux touristes dans le cadre d’une timide ouverture de l’économie cubaine – nos hôtes se font un plaisir de jouer avec notre fille, de la câliner et de lui préparer de bons petits plats.
Quand les bateaux de croisière arriveront...
Dans les restaurants, les serveurs font tout pour la charmer, finissant par la prendre dans leurs bras et nous permettant de profiter de nos premiers dîners romantiques depuis des mois. Notre fille adore toute cette attention. Et elle a l’air d’adorer Cuba, aussi : elle n’arrête pas de sourire pendant tout le voyage, malgré la chaleur et les journées à rallonge. Elle reviendra avec pas moins de trois sets de maracas offerts par des admirateurs.
 Une chambre d'hôtes à La Havane, en juillet 2015 (AFP / Yamil Lage)
Une chambre d'hôtes à La Havane, en juillet 2015 (AFP / Yamil Lage)Mais comme tous les autres voyageurs américains que nous rencontrons – et il y en a beaucoup, venus de manière légale ou non – j’hésite un peu à vanter les charmes de cette île si atypique. Comme me le dit un Américain que j’interviewe, un Catholique venu assister à la visite du pape via un vol charter affrété par l’archidiocèse de Miami, « les choses commenceront à changer (quand) les bateaux de croisière arriveront ».
Car la crainte est que Cuba, l’un des derniers endroits au monde encore vierge de la culture américaine de consommation, devienne juste une énième île touristique des Caraïbes quand l’embargo disparaîtra.

Des Cubains prennent en photo des touristes américains à La Havane, en septembre 2015
(AFP / Yamil Lage)
Je dois admettre que c’est justement ce qui m’a toujours fasciné avec ce pays : qu’il soit à la fois si proche et si éloigné des Etats-Unis. J’ai grandi dans les années 1980, dans une Amérique encore très engagée dans la Guerre froide. Je n’ai pas vécu les pires années des relations américano-cubaines, mais mes parents, oui. Ils m’ont raconté des histoires un peu inquiétantes, sur des exercices d’entraînement organisés à l’école pour se préparer à une éventuelle attaque nucléaire, en pleine crise des missiles.
L'antithèse de l'Amérique
Ma mère avait une bonne plaisanterie à ce sujet : selon elle, la consigne pendant l’entraînement c’était « penchez-vous, mettez votre tête entre vos jambes et embrassez votre joli derrière une dernière fois ».
Pour ma génération, toutefois, c’était un peu flou. On savait que le bloc soviétique était l’ennemi, que le communisme, c’était le mal… mais pourquoi ?
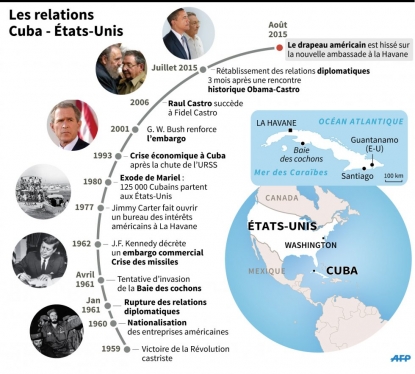
A l’adolescence, j’avais envie d’en savoir plus. Et cette curiosité envers Cuba, censée être l’antithèse de l’Amérique, n’a toujours pas disparu.
Par exemple, je me demandais :
- Quel produit vaisselle utilisent-ils ? (vietnamien, en fait)
- A quoi ressemble leur papier toilette ? (en fait il est un peu comme le nôtre, mais il est plus fin et sans petits trous… en tout cas les spécimens que j’ai vus)
- Y a-t-il un équivalent local du McDonald’s ? (oui, en effet, mais les hamburgers que nous commandons se révèlent être une tranche de porc entre deux pains, sans laitue, ni tomate, ni sauce)
- Ont-ils le moindre produit américain ? (énormément, du Coca-Cola que l’on trouve partout au dernier film des tortues Ninja, annoncé au cinéma)
 Slogan dans une rue de La Havane en février 2008: "Sans la révolution, il n'aurait même pas été possible de rêver..." (AFP / Luis Acosta)
Slogan dans une rue de La Havane en février 2008: "Sans la révolution, il n'aurait même pas été possible de rêver..." (AFP / Luis Acosta)Plus sérieusement, je voulais tout simplement savoir ce que c’était de vivre sous le communisme. Mon alter ego romantique de 20 ans serait un peu déçu de la réponse que j’ai trouvée aujourd’hui, en me rendant à Cuba : cette vie n’est pas très jolie.
Double économie
Tout d’abord, il y a la question de l’égalité. A 20 ans, j’imaginais Cuba comme une utopie égalitaire. Mais la première chose que vous remarquez en arrivant comme étranger sur cette île, c’est qu’il y a deux économies séparées, avec deux monnaies distinctes.
Les étrangers et l’élite cubaine utilisent le peso cubain convertible (CUC), à peu près équivalent au dollar et utilisé dans les restaurants, les hôtels et les boutiques de luxe. Les Cubains ordinaires n’y ont pas accès et doivent se contenter du peso… ordinaire. Ils vivent donc dans une économie beaucoup plus restreinte.
 Arrestations pendant un rassemblement anti-gouvernemental à La Havane, en septembre 2011 (AFP / Adalberto Roque)
Arrestations pendant un rassemblement anti-gouvernemental à La Havane, en septembre 2011 (AFP / Adalberto Roque)Et puis il y a la question de la répression opérée par le gouvernement, que j’ai sentie comme pesante et omniprésente, dans la moiteur tropicale. Même en tant que visiteurs, nous sommes constamment surveillés par les Comités de défense de la révolution (CDR), composés d’habitants espionnant leur voisins pour le régime castriste.
Comités de défense de la révolution
La première chose que nous devons faire, en arrivant dans une nouvelle casa particular, c’est donner nos passeports pour permettre aux propriétaires d’informer le CDR local de notre arrivée. Un moyen de garder un œil sur nous, mais aussi d’empêcher les propriétaires de se faire payer au noir, pour éviter les énormes taxes du gouvernement. Les gens que nous rencontrons à Cuba nous ont décrit à quel point les CDR surveillent la vie de chacun.
Un journaliste cubain, qui est gay, me raconte ses années de peur quand Fidel Castro menait une dure politique répressive envers les homosexuels. « Si le responsable local du CDR découvrait que vous étiez gay, vous pouviez tout perdre. Vous n’aviez plus jamais le droit de travailler. Même chose s’il apprenait que vous aviez de la famille partie vivre à Miami ».
 Un policier cubain lit une déclaration le jour de la rentrée dans une école primaire de La Havane, le 2 septembre 2013 (AFP)
Un policier cubain lit une déclaration le jour de la rentrée dans une école primaire de La Havane, le 2 septembre 2013 (AFP)Le régime a aussi ses défenseurs, comme le propriétaire de la première casa particular où nous logeons : une femme adorable, Julia, qui a travaillé dans le contre-espionnage et plaisante avec moi sur le nombre de fois où il avait fallu déjouer les plans américains pour assassiner son patron, Fidel.
Julia, dont le vaste appartement est à deux pas du fameux Hotel Nacional, chante les louanges du gouvernement en matière de santé, d’éducation et d’égalité.« Quand j’étais une petite fille, les enfants pauvres comme moi, ou les enfants noirs, ne pouvaient même pas venir dans ce quartier », nous raconte-t-elle. Ce qui est vrai.
Mais les Cubains qui n’ont rien à voir avec le contre-espionnage ou qui n’ont aucun lien avec la famille Castro se montrent généralement plus critiques.
 Une Chevrolet 1954 à La Havane, en mai 2007 (AFP / Rodrigo Arangua)
Une Chevrolet 1954 à La Havane, en mai 2007 (AFP / Rodrigo Arangua)Il reste toutefois quelque chose de beau dans le mode de vie sur cette île : avec leur capacité magique à faire rouler de vieilles voitures américaines, leur électroménager usé qui bourdonne, leurs bâtiments coloniaux qui tiennent encore debout par miracle, les Cubains montrent qu’il existe une alternative à ce que le pape François appelle « la culture jetable ».
Malheureusement, ce n’est pas un style de vie qu’ils ont choisi. Ils le subissent, c’est tout. S’ils n’étaient pas isolés depuis un demi-siècle par les Etats-Unis, ils se seraient débarrassés de leurs emblématiques Chevrolet des années 1950… comme l’ont fait il y a longtemps les Américains.
J’imagine que l’île va beaucoup changer dans les années à venir. J’espère que la plupart de ces changements iront dans le bon sens… Avec un peu de chance, je pourrai y revenir un jour et le vérifier moi-même.
J’adorerais repartir à Cuba avec ma fille et lui raconter comme c’était, quand elle était bébé. Peut-être que cette fois-là, elle pourra y aller tout simplement avec son passeport américain.
Joshua Howat Berger est correspondant de l’AFP à Montevideo, siège régional de l’agence pour l’Amérique latine. Cet article a été traduit par Katell Abiven (lire la version originale en anglais).
 La bannière étoilée est hissée à nouveau à l'ambassade des Etats-Unis à La Havane, en présence du secrétaire d'Etat John Kerry, après le rétablissement des relations diplomatiques américano-cubaines, le 14 août 2015 (AFP / Pablo Martinez Monsivais - pool)
La bannière étoilée est hissée à nouveau à l'ambassade des Etats-Unis à La Havane, en présence du secrétaire d'Etat John Kerry, après le rétablissement des relations diplomatiques américano-cubaines, le 14 août 2015 (AFP / Pablo Martinez Monsivais - pool)

